plan du dst
1) Réalisme contre romantisme
a) Clarté du dessin
b) Composition horizontale et place de la signature
2) Dur labeur des travailleurs
a) Travail en clair-obscur
b) Homme de dos sans visage
c) Haillon et Paysage vide
3) Réalisme comme révélation du réel.
a) Peinture à l’œil et non d’idée
b) Zola contre Proudhon
corrigé de l’analyse plastique
Courbet a peint les « casseurs de pierres » en 1849, et l’expose au Salon. C’est la première fois qu’il y participe avec un grand nombre de toiles, et il y remporte de premiers succès. Nous allons en faire une analyse plastique des « casseurs de pierres », qui mettra en évidence les nouvelles techniques utilisées par le peintre qui cherche alors à prendre ses distances avec le romantisme. Nous nous demanderons ce qui le pousse à donner autant d’importance au dur labeur des travailleurs.
Dans les « casseurs de pierres », le dessin et la composition ont été élaborés avec soin.
Dès le premier abord, on est frappé par la grande clarté du dessin des deux casseurs de pierres. Les contrastes sont forts et les contours très nets. Courbet reste influencé par ses premiers maîtres néoclassiques, comme Charles-Antoine Flajoulot qui fut élève de David. Pour les artistes de la fin du XVIIIème en effet, la clarté du propos est souhaitable pour que leur travail soit « honnête « : Ingres disait que « le dessin était la probité de l’art ». Même si ses toiles sont peintes en atelier, Courbet travaille d’après ses croquis réalisés sur le motif. Cette importance du dessin sur le motif est aussi une influence des peintres néoclassiques. Pierre-Henri Valencienne en 1799, insiste sur la nécessité de peindre « sur le site » des détails de paysage qui seront ensuite utilisés dans de futures compositions. Dans le cas des « casseurs de pierres », on connaît une étude préparatoire dans laquelle Courbet avait déjà précisé la place de tous les éléments de la composition définitive.
Seule la signature a changé de place dan la toile finale de Courbet. Elle est passé de droite à gauche, mais reste cependant au même niveau, comme si Courbet voulait insister sur cette horizontalité. Les classiques , comme Poussin en 1642, composaient leurs paysages avec des diagonales qui entrainaient peu à peu le regard vers le fond du tableau. De même, Corot en 1826, compose encore le « pont de Narni », en diminuant l’importance des horizontales dans la toile finale par rapport à celle réalisée sur le motif. Ces exemples montrent bien ce que les compositions de Courbet ont de remarquable. En effet, les deux casseurs sont au même niveau, horizontale encore répétée par la ligne dessinée par la limite de l’ombre derrière eux. Contrairement à ce que voulait Poussin, le regard ne peut s’enfoncer dans la toile, malgré le coin de ciel laissé encore par Courbet en haut à droite. Le regard reste comme bloqué sur les deux travailleurs, sans échappatoire possible. Cette composition donne une grande force à ce que nous montre le peintre, car notre regard bute sur ses motifs. Il reprendra ce choix de composition en 1850 pour « l’enterrement à Ornans » où l’horizontale de la fosse est répétée par la foule qui accompagne le mort, puis encore une troisième fois par les falaises typiques du paysage d’Ornans.
Dès ses premières toiles comme « l’autoportrait au chien noir » qui témoignait encore d’une mise en scène plus romantique, Courbet accordait une grande place au dessin et à la composition. Ce souci ne fera que s’accroître encore au cours des années 1840.
Le travail sur la lumière cherche à nous montrer combien la condition humaine est difficile pour les travailleurs du XIXème siècle.
Les deux casseurs de pierres sont travaillés en clair-obscur. Leur chemise claire se détache sur le paysage dans l’ombre. En 1849, Courbet fait un voyage avec Champfleury en Hollande où il découvre les peintures de Frans Hals et Rembrandt. C’est sans doute là une des origines de son travail sur la lumière, et de son goût pour les fonds sombres. Pour les « casseurs de pierres », comme pour la plupart de ses autres toiles, Courbet commence par travailler avec des terres ou même des noirs, sur lesquels les blancs vont créer des contrastes violents, comme chez le Caravage ou Rembrandt. Ce travail sur fond sombre permet, comme autrefois chez les peintres vénitiens, de créer des contrastes forts entre des parties très présentes dans le tableau et d’autres plus légères. Le Tintoret dans le « Baptême du Christ » de la Scuola san Rocco en use très largement. Courbet utilise son fond sombre pour donner une grande présence à ses personnages. C’est évident pour le chapeau du personnage de droite qui se détache sur le fond sombre. Mais cela l’est aussi pour les chemises blanches. On est loin ici de l’évanescence des impressionnistes qui peignent sur fond clair. Les chemises blanches de Courbet sont peintes sur des dessous sombres, ce qui leur donne une grande présence malgré leur luminosité. Pour se convaincre de ces différences, il suffit d’opposer une toile de Monet à une de Whistler qui, ami de Courbet, restait attaché au fond sombre.
Les deux travailleurs semblent sans visage, sans humanité. Comme dans le « 3 mai » de Goya, où les bourreaux n’avaient pas de visage pour montrer la sauvagerie de l’armée de Napoléon, Courbet cache leur visage pour montrer combien leur travail est inhumain. Dans « du principe de l’art et de sa destination sociale, Proudhon souligne combien Courbet met en évidence la violence faite à l’homme quand il est asservi au travail et à l’essor de la société capitaliste. « Les Casseurs de pierres, au rebours, crient par leurs haillons vengeance contre l’art et la société ; au fond, ils sont inoffensifs et leurs âmes sont saines. » » écrit Zola en faisant parler Proudhon en 1865.On sait l’amitié que Courbet portait au philosophe, mais faut-il vraiment asservir la toile à son seul message ? Zola ne le pense pas.
Courbet est avant tout peintre. Il a une amitié pour le socialisme et participe à la Commune, mais on peut se demander si ces quelques engagements politiques n’ont pas été encouragés par sa volonté de défendre son art. Courbet a eu une véritable politique de reconnaissance, n’hésitant pas à organiser lui-même ses expositions comme en 1855 pour le « pavillon du Réalisme ».
Ingres dit de Courbet que c’est un « œil ». Par là il entend que cette « peinture à l’œil » est à l’opposé d’une « peinture d’idée ». En effet, pour Courbet comme pour Zola, « rien n’est fâcheux comme la peinture d’idées ». Contrairement à ce que préconise Proudhon, Courbet cherche à voir dans le moment même où il peint. Il voit parce qu’il peint. Courbet en conclue : « Dès que le beau est réel et visible, il a en lui-même son expression artistique. Mais l’artiste n’a pas le droit d’amplifier cette expression. Il ne peut è toucher qu’en risquant de la dénaturer, et par suite de l’affaiblir. Le beau donné par la nature est supérieur à toutes les conventions de l’artiste. Le beau comme la vérité est une chose relative au temps où l’on vit et à l’individu apte à la concevoir. L’expression du beau est en raison directe de la puissance de perception acquise par l’artiste. »
« les casseurs de pierres » est une des premières toiles où Courbet s’affirme comme réaliste et réussit à délivrer un message politique justement parce qu’il cherche à peindre avant même de dénoncer le travail populaire. Courbet est d’abord un œil et c’est ce qui lui permet de comprendre le monde. Comme les voulait les romantiques, la peinture est devenue un moyen de connaissance. Mais cela est devenu possible justement par cette plus grande objectivité recherchée par l’artiste.
Quelques écrits où il est question de
« Les Casseurs de pierres » 1849.
Huile sur toile, 159×259 cm,
le tableau fut détruit au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Jules Vallès
« C’était, je crois, en 1850. Nous nous promenions, quelques amis et moi (le plus vieux pouvait bien avoir dix-huit ans), à travers les galeries de l’Exposition. Tout d’un coup, nous nous arrêtâmes en face d’une toile qui, sur le livret, s’appelait lesCasseurs de pierres, et qui était signée en lettres rouges : G. Courbet.
Notre émotion fut profonde.
Nous étions tous des enthousiastes. C’était l’époque où fermentaient les têtes ! Nous avions au fond de nos cœurs le respect de tout ce qui était souffrant ou vaincu, et nous demandions à l’art nouveau d’aider, lui aussi, au triomphe de la justice et de la vérité.
Ce tableau teinté de gris, avec ses deux hommes aux mains calleuses, au cou halé, était comme un miroir où se reflétait la vie terne et pénible des pauvres. La raideur gauche des personnages servait encore à l’illusion : et l’inhabileté ou le génie du peintre avait, dans un geste, indiqué l’immobilité fatale à .laquelle est condamnée, sous un ciel ingrat, toute la race des mercenaires.
A quelques pas de là nous vîmes, sous la même signature, un enterrement que suivaient des bedeaux au nez poilu, veiné, avec des trognes comme des nœuds d’arbre ; derrière, sublimes de grâce et de douleur, des femmes habillées de noir pleuraient ! On se serait cru au cimetière même, et l’on reconnaissait les chantres ivrognes, qui, avant de mettre leur surplis, vous avaient coudoyé en sortant du cabaret ! C’était d’une fidélité terrible. Ici le cynisme indifférent, là, la douleur muette. En deux coups de pinceau l’artiste avait tracé la comédie, le drame, et peint avec une horrible sincérité ces contrastes, cette ironie et ce désespoir !
La foule s’arrêtait devant ces toiles, mais avec plus de stupeur que d’émotion ; et le lendemain, au lieu de rassurer cette foule, la critique faisait chorus avec elle ; elle poussait à l’indignation contre les hardiesses du peintre.
Courbet fut traité de vaniteux féroce et de charlatan comique. Quand il eut ajouté aux Casseurs de pierres et à l’Enterrement d’Ornans les Lutteurs et la Baigneuse, tout fut dit. Il devait pendant quinze ans être appelé un excentrique, et passer aux yeux de la foule pour un fanfaron de vulgarité. »
La Rue - Courbet
Jules Vallès
Emile Zola
« Proudhon a vu comme moi les tableaux dont je parle, mais il les a vus autrement, en dehors de toute facture, au point de vue de la pure pensée. Une toile, pour lui, est un sujet ; peignez-la en rouge ou en vert, que lui importe ! Il le dit lui-même, il ne s’entend en rien à la peinture, et raisonne tranquillement sur les idées. Il commente, il force le tableau à signifier quelque chose ; de la forme, pas un mot.
C’est ainsi qu’il arrive à la bouffonnerie. Le nouveau critique d’art, celui qui se vante de jeter les bases d’une science nouvelle, rend ses arrêts de la façon suivante : Le Retour de la foire, de Courbet, est « la France rustique, avec son humeur indécise et son esprit positif, sa langue simple, ses passions douces, son style sans emphase, sa pensée plus près de terre que des nues, ses mœurs également éloignées de la démocratie et de la démagogie, sa préférence décidée pour les façons communes, éloignée de toute exaltation idéaliste, heureuse sous une autorité tempérée, dans ce juste milieu aux bonnes gens si cher, et qui, hélas ! constamment les trahit ».
La Baigneuse est une satire de la bourgeoisie : « Oui, la voilà bien cette bourgeoisie charnue et cossue, déformée par la graisse et le luxe ; en qui la mollesse et la masse étouffent l’idéal, et prédestinée à mourir de poltronnerie, quand ce n’est pas de gras fondu ; la voilà telle que sa sottise, son égoïsme et sa cuisine nous la font. »
Les Demoiselles de la Seine et Les Casseurs de pierres servent à établir un bien merveilleux parallèle : « Ces deux femmes vivent dans le bien-être… ce sont de vraies artistes. Mais l’orgueil, l’adultère, le divorce et le suicide, remplaçant les amours, voltigent autour d’elles et les accompagnent ; elles les portent dans leur douaire : c’est pourquoi, à la fin, elles paraissent horribles. Les Casseurs de pierres, au rebours, crient par leurs haillons vengeance contre l’art et la société ; au fond, ils sont inoffensifs et leurs âmes sont saines. »
Et Proudhon examine ainsi chaque toile, les expliquant toutes et leur donnant un sens politique, religieux, ou de simple police des moeurs. »
Mes Haines, Le Salut Public, 26 et 31 août 1865
Emile Zola
Pierre-Joseph Proudhon
» Les Casseurs de pierres sont une ironie à l’adresse de notre civilisation industrielle, qui tous les jours invente des machines merveilleuses pour labourer, semer, faucher, moissonner, battre le grain, moudre, pétrir, filer, tisser, coudre, imprimer, fabriquer des clous, du papier, des épingles, des cartes ; exécuter enfin toutes sortes de travaux, souvent fort compliqués et délicats, et qui est incapable d’affranchir l’homme des travaux les plus grossiers, les plus pénibles, les plus répugnants, apanage éternel de la misère. Nos machines en général, chefs-d’œuvre de précision, ont plus d’habileté que nous-mêmes ; elles font mieux que nous, pour peu que ce que nous leur demandons exige d’intelligence et même d’art ; une fois en mouvement, elles nous remplacent avec un immense avantage. Il n’y a qu’un reproche à leur faire : elles ne se meuvent pas d’elles-mêmes ; elles ont besoin qu’on les surveille, qu’on les gouverne et même qu’on les serve. Or, quel est le serviteur des machines ? L’homme. L’homme serf, tel est le dernier mot de l’industrialisme moderne. Il y a longtemps que le problème de la spéculation capitaliste, consistant à reporter chaque année au compte de capital les salaires économisés des ouvriers, serait résolu, si la mécanique avait pu, de son côté, résoudre celui du mouvement perpétuel ; si, en définitive, le moteur originel de l’industrie pouvait être autre que l’homme….
Voilà, direz-vous, bien de la philosophie à propos d’un tableau ! Qui empêche d’inventer une machine à casser les pierres, comme on en a inventé une pour les scier ? M. Courbet n’aurait eu alors rien à dire. — A quoi je réponds : Courbet eût tout simplement modifié son sujet, car l’idée serait demeurée exactement la même, le problème étant insoluble. Une invention en appelle une autre ; de sorte que, pour esquiver toute main-d’œuvre, nous tombons dans le machinisme universel, aussi impossible, aussi introuvable que le mouvement perpétuel. Sans doute on ferait une machine à casser des pierres ; mais, pour être conséquent au point de vue du capitalisme, il en faudrait une autre pour les extraire de la carrière, une autre pour les charger, une pour les voiturer et les conduire, une encore poulies répandre ; ce qui n’aurait pas de fin. Ce n’est pas tout : admettant ce machinisme, que ferez-vous des malheureux qui aujourd’hui vivent de ces travaux pénibles, et qui alors, sans occupation, n’auraient pour subsister ni capital, ni propriété, ni revenu ?… Si bien qu’en résultat, l’homme est l’esclave de la machine, de la machine qu’il a inventée et construite de ses mains ; que plus nous développons autour de nous la mécanique, plus nous multiplions la servitude, et que la misère physique, intellectuelle et morale de nos esclaves est d’autant plus grande que leur besogne est plus grossière et leur fonction plus servile. Telle est la loi du travail : elle est fatale ; il n’y a pas moyen de faire qu’il en soit autrement. Que pensez-vous de cette situation ?—Elle est on ne peut plus affligeante. N’y aurait-il pas moyen d’y trouver quelque remède, quelque adoucissement ? — On n’en connaît qu’un : « c’est de répartir cette lourde tâche comme un service public, corvée ou prestation, entre tous les membres valides de la société. Hors de là il y a exploitation, asservissement des uns par les autres, partant dégradation de la race, enlaidissement. — Comment ! est-ce que l’esthétique aussi conclurait à cela ? — Sans doute, et si l’art ne s’est pas avisé plus tôt d’en dire son mot, c’est que jusqu’à l’année 1789 de Jésus-Christ. le droit de l’homme et du citoyen était resté lettre close. L’idéalisme égyptien admettait la servitude ; l’idéalisme grec, tout de même… [...]
Des paysans, qui avaient eu l’occasion de voir le tableau de Courbet, auraient voulu l’avoir pour le placer, devinez où ? Sur le maître-autel de leur église. LesCasseurs de pierres valent une parabole de l’Évangile ; c’est de la morale en action. Je recommande cette idée paysanesque à M. Flandrin : elle pourra l’éclairer dans ses compositions religieuses.
Du principe de l’art et de sa destination sociale, Chapitre V
Pierre-Joseph Proudhon







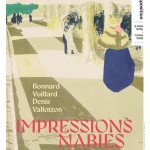


Laisser un commentaire