Désirer désobéir. Ce qui nous soulève. Tome I. Georges Didi-Huberman. Éd Minuit
Après l’exposition « soulèvement » de 2016-17 au musée du Jeu de Paume, son commissaire réunit ici les textes écrits alors qu’il préparait l’évènement. On est loin de la polémique qui s’éleva alors. Dans une chronique du journal Libération, « L’histoire sociale n’est pas de l’art », Philippe Artières avait souligné quelques problèmes posés par l’exposition. « L’exposition du Jeu de paume s’abîmant dans le modèle de l’album de Warburg, en déployant des ensembles d’images, sans jamais les contextualiser ni les inscrire dans l’histoire sociale et politique mondiale, au mieux, rate sa cible, au pire, l’atteint en faisant de chaque action de résistance aux pouvoirs un acte artistique. (… Pourtant,) Il y a urgence non à être esthète mais à se faire pédagogue.» La chronique s’achevait sur cette attaque. Cet ouvrage montre pourtant combien le propos de Georges Didi-Huberman est loin de se contenter de l’esthétique. Comme depuis ses premiers ouvrages, il ne cesse de mêler l’histoire de l’art à l’anthropologie ou à l’histoire pour nous donner à penser le monde. Pédagogique, son entreprise l’est justement! Mais elle fait plus aussi, en se rapprochant de ce que fait l’art, en créant une émotion esthétique et intellectuelle qui nous appelle, nous aussi au soulèvement.
« le cuirassé potemkine » de Einsenstein, « le fond de l’air est rouge » de Chris Marker, Delacroix, Géricault, « zero de conduite » de Jean Vigo, Goya. Ces œuvres sont exaltantes : Walter Benjamin le disait dans un texte de 1931 « le caractère destructeur. Je ne connais qu’un seul mot d’ordre : faire de la place ; qu’une seule activité : déblayer. Son besoin d’air frais et d’espace libre est plus fort que toute haine. Le caractère destructeur et jeune et enjoué. » L’ouvrage entier tente de rendre compte de ce caractère destructeur qui préside à tout soulèvement. Certains ont pu reprocher l’atmosphère pesante des premiers chapitres, basés sur le célèbre drapé qui enveloppe les mutins avant leur exécution dans le « cuirassé Potemkine ». Les chapitres suivants montrent cependant la complexité des forces de désir qui président à tout soulèvement. Aby Warburg, Michaux où Walter Benjamin sont tour à tour convoqués par l’auteur pour comprendre la complexité de ces soulèvements. Se soulever, c’est d’abord remettre en question le monde ancien. « Ce qui nous soulève, ce sont le désir bien sûr. Mais pourquoi nos désirs sont-ils voués à « s’exaspérer dans le soulèvement ?» Pourquoi semblent-ils tous si nécessaires et pourtant se perdre toujours dans l’échec ? Les planches de « Mnémosyne » de Warburg montrent des motifs qui sans cesse, changent de signification. Elles doivent être complétées par les analyses de W.Benjamin sur notre besoin de destruction. Georges Didi-Huberman se demande avec le poète Michaux vers quoi nous nous soulèvons. Michaux voit « un défenestrées (qui) enfin s’envole ». « Soulèvement, donc : puissance de, ou dans, l’impouvoir même. Puissances natives. Puissances naissantes, sans garantie de leur propre fin, donc sans garantie de pouvoir. (…)Il faudra donc admettre, comme prémisse nécessaire à toute réflexion sur les formes du soulèvement, la distinction conceptuelle entre puissance et pouvoir». L’auteur rappelle les événements politiques récents comme le soulèvement des mères et des grands-mères de la place de mai à Buenos Aires en 1983, ou encore des analyses de Freud du « rêve qui nous mène dans l’avenir puisqu’il nous montre nos désirs réalisés ». L’auteur passe sans cesse des œuvres d’art, aux textes littéraires, ou à l’actualité politique. Georges Bataille par exemple, participait au cercle communiste démocratique de Boris Souvarine en 1933, pour développer ce qu’il nommait une sociologie sacrée du monde contemporain : il est urgent alors, de désirer pour désobéir aux fascismes naissants. Georges Didi-Huberman analyse ainsi toutes les occurrences de la révolte parmi les intellectuels du 20e siècle. « L’homme révolté » de Albert Camus paru en 1951 permet à l’auteur de préciser encore un peu plus ce qu’est la révolte. Il cite Camus : « l’histoire des hommes, en un sens, est la somme de leur révoltes successives : « Je me révolte, donc nous sommes. » L’auteur analyse la controverse qui opposa Camus avec d’un côté « André breton, dans le rôle du visionnaire aveugle par excellence et Jean-Paul Sartre dans le rôle du philosophe de ( la ) mauvaise foi». L’auteur les confronte tous les trois à Georges Bataille : « pour Albert Camus, comme pour le surréalisme, il s’agit de trouver dans la révolte un mouvement fondamental où l’homme assume pleinement son destin. (…) Il n’est pas difficile de reconnaître dans toutes ces discordances l’opposition fondamentale de la puissance et du pouvoir. » Dans le chapitre masse et puissance, l’auteur analyse à partir des écrits de Freud et de Canetti, la tendance des individus à se fondre dans la masse pour gagner en puissance. Il s’agit de comprendre la différence entre puissance et pouvoir : les individus qui se fondent dans la masse gagnent ainsi en puissance. Dans le chapitre, « éros politique « , Georges Didi-Huberman repart des textes de Hegel. Le désir y apparait comme ce qui permet de se « soulever ». Marcuse écrivait déjà Pour commenter Hegel : « c’est seulement dans et avec cet être pour autrui que la vraie autonomie liberté(…), peut se réaliser. Dans « éros et civilisation », Marcuse définit en 1955 le désir et le politique comme intimement liés. « Le renoncement pulsionnels devient renoncement au désir, c’est-à-dire répression, et celle-ci devient une large structure d’aliénation ou de réification physique et psychique, aboutissant à une morale d’esclave fomentée, exigée par les maîtres du jeu social. On comprend alors que Marcuse puisse d’emblée protester contre cette évidence selon laquelle « La civilisation exige une répression de plus en plus intense ». Marcuse essaye de dépasser l’aliénation imposée par le principe de réalité de Freud. Selon Marcuse, il y aurait une nécessaire « fonction critique de l’imagination » : on comprend ce qui le faisait apprécier par les révoltés de mai 68. On est loin du pessimisme que Zoé Carle lui reprochait à la sortie de cet ouvrage. « Dès lors que les désirs, y compris sexuels, trouveraient une forme capable de se libérer des barrières de la domination sociale : une forme tout à la fois d’affirmation et de « grand refus », comme il dit. Une forme de « protestation » (protest). Une image de la « lutte pour la forme ultime de la liberté »(struggle for the ultimate form of freedom) dira t-il encore. Et c’est comme si les « larmes d’Eros » faisaient désormais place à un Eros lui-même compris comme une arme décisive contre nos servitudes contemporaines. En1964, Marcuse publiair l’homme unidimensionnel, réquisitoire implacable contre la société capitaliste moderne. ». « S’il est vrai que le désir est indestructible, il faut alors chercher ce qui, dans les plis ou dans les trous de cette « société unidimensionnelle », dans les ombres ou les failles des « formes réifiées », laisse une possibilité pour le désir de créer, non pas un pur fantasme, mais une réalité, une pratique alternative aux servitudes communes. Éros, donc : c’est la façon marcusienne de reprendre, de reconduire les motifs de l’espoir chez Walter Benjamin donc de l’utopie Ernst Bloch. Voilà pourquoi ce livre me paraît capital pour aujourd’hui. Face à une réalité qui, plus que jamais, nous impose de rester à nos places, cette réflexion nous montre pourquoi des hommes ont pensé au XXème que le soulèvement était incontournable. Devant les fascismes naissants ou à la suite de leur écrasement, ils ont trouvé la force de résister. Cet essai arrive à point pour nous aider dans une lutte toujours à recommencer.

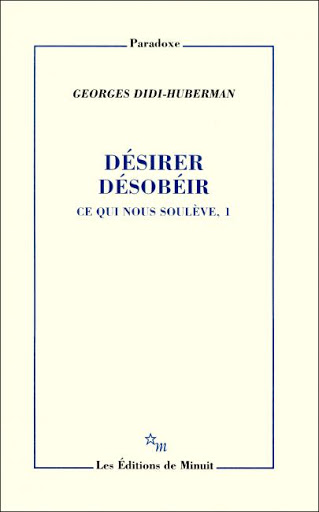











Laisser un commentaire